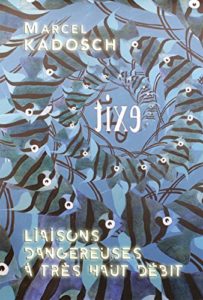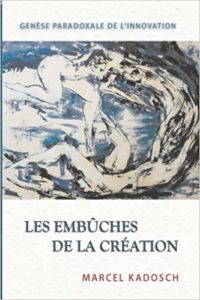Parménide a vécu il y a 2500 ans, à Élée, au sud de la Campanie, au nord de laquelle se trouve le Monte Circeo où la légende situe la demeure de la magicienne Circé, dont les sortilèges et les amours avec Ulysse sont contés au chant X de l’Odyssée. Parménide aurait eu son akmé (40 ans) à l’époque de la bataille de Salamine qui a établi la puissance d’Athènes. Parménide est considéré comme l’inventeur de la philosophie, mais le mot n’existant pas encore, il ne se considérait pas plus philosophe que Jésus ne se nommait chrétien, n’ayant pas rencontré Paul.
Il s’est exprimé par un long poème intitulé : De la Nature (Peri phuseos), dont des fragments plus ou moins longs formant 160 vers nous saaont parvenus. Il commence par se présenter comme un jeune homme dans un préambule lyrique, mais passe aussitôt la parole à une déesse anonyme, parole qui expose et impose sa « vision du monde », sa philosophie, sous couvert de cette déesse : un mode d’exposition singulier qui suscite beaucoup de commentaires. que veut démontrer Parménide ?
Il n’accepte pas le devenir circulaire perpétuel d’Héraclite. Il soupçonne que des illusions des sens produisent ce fleuve d‘apparences, dont il veut sortir en se fiant à la seule raison, décrivant ce que devrait être un « monde » purement rationnel. Une première vérité ainsi découverte est que le devenir d’Héraclite, est un fleuve d’apparences qui ne sont qu’illusion. Les sens sont trompeurs et donnent au surplus le point de vue subjectif d’un seul individu : leur multiplicité engendre la multiplicité des opinions. Si on définit ce « monde » par un grand nombre d’attributs, cela induira des contradictions, dont il essaye de dégager l’idée d’un monde : ces attributs dont la représentativité peut être discutée déforment l’objet qu’on veut représenter. Il espère réduire cette diversité, trouver par la raison le même dissimulé par les apparences derrière l’autre. Il retrouve un à un des attributs essentiels du « monde » par le raisonnement seul qui est son arkhé.
Il est instructif de suivre dans un certain détail cette manière de décrire un « monde » perçu par le seul esprit (logos) en faisant abstraction des sens et des opinions des mortels (broton doxas), et de faire apparaître ainsi en sens inverse un autre type d’illusions : celles engendrées chez un être ne cherchant à utiliser que son seul cerveau pour connaître le « monde ». Or si l’on s’en tient au seul Poème, ce « monde » n’apparaît qu’à la fin du fragment 8 (v.60) : diakosmon eoikota panta, l’arrangement du monde dans toute sa vraisemblance ; et « l’univers » au début du fragment 9 : pan pleon estin homou phaéos kai nyktos ; l’univers est rempli de lumière et de nuit ensemble, donc bien après que la déesse de Parménide ait exposé toute sa doctrine (fr. 1 à 8).
La description de ce « monde » n’en contient pas moins le soubassement des conclusions, auxquelles parvient ce philosophe. Commençons donc par rappeler ses intentions dans ce domaine, quel est ce « monde » qui semble avoir été imaginé dans sa seule tête, les yeux bandés, la bouche fermée, les oreilles et le nez bouchés, si tant est que sa raison avait seulement conscience d’une science, avant d’aborder son apport à la philosophie, dicté par la déesse, qui expliquera comment il y est parvenu.
Le monde est. Il est ce qui existe, l’étant : to eon. Au delà il n’y a rien, puisque tu ne peux connaître, exprimer ce qui n’existe pas. Le monde est un attribut esentiel, l’être du monde matériel. En tant qu’étant, il ne peut être qu’Un ; mais il est tout l’espace, qu’il occupe entièrement, donc il n’y a pas de vide et le monde est continu et indivisible, d’un seul tenant ; à l’inverse de ce qu’affirme Héraclite, il ne peut venir d’un non-être qui ne saurait exister : le plus ne peut venir du moins, donc le monde n’a ni naissance ni mort, ni commencement ni fin ; il est éternel. En tant qu’étendu, le monde est limité, fini ; la limitation dans l’espace exclut le mouvement, qui est le passage du même à l’autre ; cela n’est possible qu’à partir d’un repère extérieur au mobile supposé : mais rien de lui ne lui est extérieur ; si le monde est tout l’espace, il n’y a pas de dehors ; le mouvement serait un changement de position de quelque chose par rapport à quelque chose : il ne peut y avoir de mouvement par rapport à un vide. Si le monde est le même dans toutes les directions, il est sphérique ; mais s’il est sphérique ne pourrait-il se mouvoir par une poussée rotative autour de lui-même ? Ce n’est pas possible faute de repère : l’étant-un ne peut se mouvoir vers un autre étant qui n’existe pas, ni vers le non-étant qui n’existe pas non plus.
Les fragments du poème qui suivent, souvent cités, où : to au-to, le même, répété deux fois, identité et réalité, exprime la conception de la vérité vraie et véritable selon Parménide, jouent un rôle de premier plan:
– « le même, lui, est à la fois penser et être »(fr.3).
-« or c’est le même, penser et ce à cause de quoi il y a pensée »(fr.8, v.34).
Parménide s’est ainsi présenté comme un physicien, qui proposait une description du monde, de l’univers matériel, différente du monde sensible. L’hypothèse rationnelle d’un monde un implique logiquement l’immobilité. Elle donne tort au sens commun : le physicien prenant la raison comme guide doit conclure que le monde sensible reconnu par nos sens est irréel, une illusion trompeuse produite par les sens, une hallucination.
On doit aussi à Parménide le concept du point sans épaisseur, de la surface sans épaisseur d’un volume, de la ligne sans largeur, éléments de base de la géométrie : si l’être est indivisible, les figures géométriques ne sont pas des choses, mais en fait les illusions créatrices de la géométrie : de pures abstractions. Parménide n’utilise pas ce mot mais parle de «choses absentes, sans réalité» : apéonta, plutôt que de «non-étants», sans être, dont on verra qu’elles sont impensables. Selon lui, les «définitions négatives» : oi apophatikoi logoi, comme celles qui dénient l’existence matérielle aux éléments géométriques, conviennent aux principes[1], font partie de l’arkhé .
Pour décrire sans l’aide des sens un monde aussi rationnel que possible, il adhère à la physique issue de l’école pythagoricienne, pour qui tout est nombre : c’est un vrai principe, avec les figures géométriques, « choses absentes » dont on déduit les éléments matériels, associés aux polyèdres réguliers : le plus pointu, le tétraèdre forme le feu, le plus lisse ayant vingt faces, l’icosaèdre forme l’eau, les cubes à six faces qui s’entassent jointivement forment la terre. Parménide a retenu l’idée que les éléments sont des formes : «Les mortels ont nommé deux formes, dont une seule est nécessaire, et c’est là qu’ils sont aberrants»( fr.8, v.53,54). La raison et les sens introduisent par ce biais un dualisme de deux domaines contraires : celui de la vérité, et celui des apparences illusoires selon l’auteur.
On pourrait donc tenir pour parménidienne l’idée que l’un des deux domaines contraires pythagoriciens soit, sinon des choses absentes : apeonta, au moins des «choses négatives», apophatikoi, au risque de contredire l’image des sens. Deux formes opposées produisent des caractères contraires : dur-mou, léger-lourd, clair-sombre, chaud-froid, etc.. Dans l’opposition léger-lourd, il est difficile de soutenir que l’un ou l’autre soit un non-étant impensable. Milan Kundera franchit imprudemment ce pas en prétendant que Parménide oppose là l’être au non-être et considère qu’un des pôles de la contradiction est positif : le léger, la grâce, et l’autre négatif : le lourd, la pesanteur, choix qui lui paraît mystérieux et ambigü[2]. Pourtant Parménide a fait correspondre le léger (kouphon) à la flamme, et le lourd (bary) à l’ombre, mais en admettant qu’il ait accordé à l’être une insoutenable légéreté, il n’a pas reconnu en revanche le non-être, qu’il a laissé impensé.
Sur la structure du monde sphérique on n’a pas la description de Parménide lui-même, mais un texte obscur, sans doute mal compris par le doxographe Aetius ou Stobée mais intéressant : le monde réel est présenté comme un emboîtement de couronnes concentriques semblables à des poupées russes, entre une enveloppe d’éther condensé dur, obscur, qui maintient le monde dans sa limite, et un noyau de même nature. La partie intermédiaire contenant des mélanges de contraires (summiga) est une source de génération de mouvements contraires, peut-être comme ceux des plateaux d’une balance qui se composent pour produire et maintenir un équilibre : contraires qui aboutiraient à l’immobilité par une obligation logique, que nous appelons la stabilité, et qui est appelé par le commentateur:
daimona kubernétin ; kleidoukhon ; dikèn ; anagkèn. Soit :
destinée pilotée ; gardien ; justice ; nécessité.
Soit encore aujourd’hui :
sortie d’ampli, consigne, régulation, contrainte.
Parménide a peut-être pressenti cette modernité scientifique pour sauver son monde immobile de contraires. Ce monde serait alors vraiment très proche de la cybernétique, et il définit bien comme destinée l’atteinte de l’immobilité recherchée, maintenue stable par un gardien, un berger de la consigne. Notons cependant dans le fragment 10 (v. 5-7) du poème la référence à la nécessité, qui « enchaîne le ciel étendu autour pour servir de borne aux astres » : « ouranon amphis ekhonta…agous epedêsen peirat’ekhein astrôn » : cette nécessité enchaînant le ciel étendu autour qui limite les astres est la même que celle qui tient l’étant dans les liens de ses bornes (fr.8, v.31) pour l’éloigner des illusions des sens et des opinions des mortels, de la doxa, à l’imitation des compagnons d’Ulysse qui le ligotent au mât du navire pour l’empêcher de suivre les sirènes au chant divin[3].
Mais on peut rechercher un autre mode de production de l’immobilité : l’enracinement dans la terre de minéraux. Les êtres ainsi produits ne peuvent avoir aucun organe leur permettant de se mouvoir, de vivre : semblables aux figures géométriques, ils sont définis négativement par des apeonta ; ces «choses absentes» en font des objets renfermés sur eux-mêmes : non pas comme les autistes qui refusent de communiquer avec leur environnement externe, mais parce que cet environnement n’existe pas dans le monde de Parménide qui n’a pas d’extérieur, non plus que ces objets qui sont le miroir de ce monde parménidien, dont ils apparaissent comme les stoikheia. Semblables aux monades leibnitziennes, ils n’ont ni portes ni fenêtres car ils n’échangent rien[4] : ils préfigurent les atomes dont la nécessité va se faire jour pour résoudre les contradictions rencontrées.
Dans son poème, Parménide a été le premier, ou parmi les tout premiers, à tenir un langage philosophique, et s’affirmant inspiré par une déesse, il l’a inauguré par des affirmations impératives, décidant de l’être et du non-être, de l’essence de ces choses.
Parménide pose que la pensée est identique à l’être, mais que l’être et la pensée ne sont pas vraiment liés : on ne peut pas les discerner ; alors que l’être et le non-être non seulement ne sont pas liés, et sont différents, mais au surplus ils sont hétérogènes : le non-être est impossible à penser, impensable, donc interdit , Parménide en a décidé ainsi, et il a été le premier à en user de la sorte.
Quel accueil un univers partant de telles prémisses, objet artificiel créé à partir de là dans le but de philosopher, a-t-il reçu dans son environnement externe, de la part de philosophes qui se piquent par ailleurs de raisonnement scientifique, d’épistémologie, théorique ou expérimentale ?
Les conclusions de Martin Heidegger qui a beaucoup médité sur Parménide seront évoquées plus loin. Il dit que la science ne pense pas mais calcule.
Partant du fait qu’une pensée est formulable sous la forme d’un calcul, n’en déplaise à Heidegger, réalisable par un réseau de neurones, Warren Mc Culloch a construit une machine produisant ce type de formule.
Alain Badiou a repris les raisonnements de Parménide pour les disséquer[5]. Selon lui, c’est Parménide qui juge de lui-même et décide, parce que le même est pensée et être, que le non-être est impensable, interdit, impossible : condition pour que la pensée puisse être fondée, et donc pensée. A cet égard, il lit le fragment 6 du poème parménidien comme un ordre :
« Il faut dire et penser ceci : rester dans l’étant ; être est en effet,
Khrê to legein to noein t’eon emmenai ; esti gar einai (v.1)
Mais le néant n’est pas : voilà ce que je t’enjoins de considérer
Mêden d’ouk’estin ; ta s’egô phrazesthai anôga (v.2) ».
Cette impossibilité noue alors l’être, la pensée et le non-être par un nœud où chacune de ces instances lie les deux autres, ce qui est le propre du nœud borroméen : celui appliqué par Lacan à la psychanalyse où il ambitionne de représenter scientifiquement le lien R-S-I entre le réel, le symbolique et l’imaginaire par un mathème, dont ce nœud est une instance. Parménide interdit alors le non-être pour fonder la pensée comme pensée de l’être. Il ne constate pas que l’être, la pensée et le non-être sont noués : il noue lui-même le nœud ; ce nouage est sa décision, la volonté d’établir un lien.
Dans : Qu’appelle-t-on penser ?[6] Heidegger lit autrement le fragment 6, comme un appel lancé par t’eon emmenai, qu’il traduit par : l’être présent de l’étant présent : appel de la pensée dans son être qui installe le noein dans l’einai. Noein n’est pensée que sous la dépendance de : einai, où elle s’enracine, ce qui semble être aussi l’avis de Shakespeare : « Thought is the slave of life »[7].
Le dictionnaire Bailly traduit noein par: avoir (une pensée) dans l’esprit. Heidegger l’articule avec legein, un dire, un langage : la pensée n’est pensée que lorsqu’elle pense l’étant, to eon. Il traduit noein par : prendre en garde, et lit donc le fragment 3 cité plus haut :
«Prendre en garde, et aussi être présent de l’étant présent, s’entr’appartiennent. »
Pour Badiou, l’opération de nouage du nœud est bien la décision de Parménide lui-même, dictée par la déesse, donnée par Parménide en forme de sentence ou de signe : pour que l’être convoque la pensée à le penser, il faut une décision interdictrice. Barrer la voie du non être, tel est le protocole de l’opération dans lequel le nouage est prononcé. Les particularités de ce protocole sont de deux ordres :
– le non être est bien ce par quoi pensée et être tiennent l’un à l’autre : la voie du non être en est la seule garantie.
– l’interdiction est un impératif négatif : « ne fais pas cela ». Il n’y a de pensée que s’il y a une interdiction. Mais de quoi ?
« L’interdit porte donc sur un nom, à savoir que c’est de la « voie » qu’indique le nom « non être « qu’il faut s’écarter. »
-L’hétérogène pur, l’indiscernable et l’impossible seraient trois instances d’un lien minimum :
– aucun lien entre l’être et le non être , hétérogènes : l’un exclut l’autre ;
– être et pensée ne sont pas liés, mais indiscernables, identiques ;
– aucune liaison entre pensée et non-être : le non-être est impossible à penser ; la pensée ne pense pas le non être, qui reste impensé.
Parménide a donc posé trois relations, chacune entre deux instances : une relation d’identité entre être et pensée ( indiscernables, ils ne sont pas liés) ; une relation d’exclusion radicale entre être et non être, s’excluant l’un l’autre, ils ne sont pas liés ; une relation d’interdit entre être et pensée : trois rapports qui sont en fait des non-relations, niant l’existence de liens :
– être et pensée ne sont pas liés à proprement parler : on ne peut les distinguer.
– être et non être ne sont pas liés, puisqu’ils s’excluent l’un l’autre : on ne peut penser leur coprésence
– le non être est impossible pour la pensée, le non être est l’impensable de la pensée : ils ne peuvent être liés.
Badiou observe que cette manière de raisonner, ordonnant au départ un axiome et constatant des contradictions si on s’en écarte, n’est autre que la démarche du raisonnement par l’absurde, qui part lui aussi d’un impératif. Pour la première fois, on a quitté le récit, le mythe, pour introduire le premier raisonnement de forme mathématique ). Ce serait par cette innovation que Parménide a inauguré la philosophie. Qu’est-ce que le raisonnement par l’absurde ?
Soit la proposition p : elle signifie que p est vrai, elle affirme sa valeur de vérité. La proposition : non (p) dit que p est faux.
La proposition : « Si p est faux, alors non (p) » définit la négation.
La proposition : « Si non(p) est faux, alors p » est le raisonnement par l’absurde : il interdit la double négation, ii exclut la possibilité d’un tiers ; il entend prouver abstraitement l’existence d’un objet sans le montrer ; s’il faut créer l’objet, il ne dit pas comment le construire. Les philosophes constructivistes rejettent ce raisonnement pour insuffisance de preuve.
Exemple de p : l’étant est (un arbre, une girafe, une machine à vapeur, un être suprême)
Raisonnement par l’absurde : s’il est faux que l’étant n’est pas, alors l’étant est.
Le constructiviste : je l’accepterai quand vous m’aurez montré l’étant, ou fourni un moyen de le construire.
Rappelons en quelques mots la position ultérieure des post-socratiques. Il semble qu’ils aient bien senti la nécessité d’un nouage entre l’être et la pensée, mais l’interdiction du non-être était plus qu’un nœud : un bâillon étouffant. Platon le met en liberté surveillée. Pour Platon, l’être et la pensée ne sont pas le même ; il n’interdit plus le non-être, il lui donne un nom : l’autre, qui n’est pas le même, qui introduit l’expérience, tout ce qui n’est pas : naître, mourir, se déplacer, changer de couleur, etc.. Pour Aristote, l’être est ce que la pensée pense dans un espace limité par l’interdiction du langage de l’expérience ; la pensée est nouée à l’être et au non être par l’expérience, que le non-être récapitule
La déesse s’est exprimée par les mots du Poème: des mots qui sont là « dressés comme des statues archaïques grecques » écrit Heidegger ; des mots grecs, déjà difficiles à comprendre en grec, intraduisibles dans une autre langue. On ne traduit pas une statue antique, on parle, on parle, c’est tout ce qu’on sait faire.
Pour ces mots, Parménide est considéré comme le premier à avoir parlé de philosophie. Mais quels mots ? Et la question : qui a été le premier philosophe, a-t-elle un sens, et un intérêt ? S’il y a un premier, c’est un créateur, il y a une création, un commencement, ce que nie la déesse. L’être humain a peut-être commencé à élaborer ce que nous appelons une pensée bien avant d’avoir appris à écrire, avant même de parler : quand il a réussi à emmagasiner un nombre suffisant de milliards de neurones sous son crâne élargi, et une quantité suffisante de culture, acquise en imitant et répétant ce qui avait réussi. Alors Toumaï ? Adam? Mc Culloch affirme que des primates, voire des oiseaux, savent reconnaître les nombres 1 à 6, par leur aspect, mais seuls les hommes savent compter ; d’abord sur les doigts et les phalanges, mais ils ont fini par comprendre, peut-être en mettant un pied devant l’autre, chaussé, lacé différemment, qu’il suffisait de : « paille, foin ; un, deux » et de recommencer.
Badiou a déterré des prédécesseurs historiques : un papyrus égyptien et un hymne védique datant de trois siècles avant Parménide évoquent l’être, la pensée, le non-être. Ce n’est pas à proprement inaugurer la philosophie, paraît-il : Parménide a inauguré la philosophie en instaurant un nouage, l’existence de liens entre ces entités, que ses successeurs ont déclinés autrement.
M.Jourdain demandait au Maître de Philosophie qu’il lui enseigne la Grammaire. Interrogé à ce propos, Henri Atlan dont l’avis fait autorité m’a confirmé que les Hébreux ne connaissaient de l’être que le verbe, conjugué dans le tétragramme aux trois temps ; ils n’avaient pas de substantif être. Spinoza savait l’hébreu, mais il a trouvé l’être dans le latin. Est-ce important? Sous réserve que les fragments recueillis aient été numérotés dans le bon ordre, celui de l’auteur (alors que le placement du fragment 4 avant le fragment 8 est jugé « ontologiquement » invraisemblable), Parménide serait le premier grec, à avoir défini (en grec) une première bête philosophique, par un verbe participe substantivé : to eon, l’étant, apparaissant dans ce cas pour la première fois dans le fragment 4 : « tu ne sépareras pas l’étant de l’étant en le coupant car il est d’un seul tenant » : ou gar apotmêxei to eon tou eontos ekhesthai(fr.4, v.2); mais réaffirmé au fragment 6 (v.1) cité plus haut : « t’eon emmenai », « persévérer dans l’être », si j’ose encore croire mon vieux dictionnaire Bailly du lycée, discrédité par cette apparition inopinée avant l’heure de Spinoza.
Mais cette traduction a donné lieu à une subtile controverse entre grammairiens : l’un refusant la grammaire à eon traduit par « être » comme ci-dessus, l’autre déployant « l’ontologie de la grammaire » dans le passage du verbe au participe substantivé : l’étant ; tous deux acceptant que tau apostrophe devienne l apostrophe ; tous deux refusant : « l’il y a »[8].
Ainsi le discours philosophique consiste à substantiver les verbes, ce qui explique les difficultés du français, et de l’hébreu, à traduire les mots des philosophes grecs et allemands. À quel moment l’oiseau de Minerve, philosophe ou grammairien, a-t-il pris son vol « pour gauchir la destinée », le matin plutôt que le soir ? Au 17è siècle ? En 1927 ? Auparavant l’oiseau qui pense a bien dû s’arrêter quelque part pour dormir, rêver « la tête sous l’exil tout proche et lointain de ses ailes, dans une alliance confuse de feuillage et de plumes » avec l’arbre, qui est. À l’aube, « l’oiseau de son bec coupe en lui le fil du songe » pour philosopher. Il laisse l’arbre continuer seul le récit.
Ainsi « l’élément du récit est circonscrit au sujet de l’énonciation : …l’énoncé se soustrait à la figure du récit et il lui substitue autre chose. L’autorité… ne sera pas celle du récit… on aura, chemin faisant, un changement de loi[9] ». Avant même de nommer l’étant, Parménide avait déjà donné un nom à son contraire : « to mé eon » (fr.2, v.7), le non-étant, pour s’empresser de l’interdire.
Et pourtant, chemin faisant, premier philosophe ou non, Parménide a bel et bien imité un modèle médiateur générateur d’un récit : le poète Homère, qui a créé l’ancêtre en Occident des chevaliers errants, de Lancelot et Perceval à Amadis de Gaule , « le prudent et patient Ulysse, original du plus excellent maître que Don Quichotte sait », que doit imiter « celui qui veut acquérir le nom de prudent et patient »[10] ; c’est l’objet du désir de Parménide, qu’il ne choisit pas lui-même, que la déesse choisit pour lui par la voix d’Homère, médiateur prestigieux qui féconde l’imagination de Parménide pour engendrer le monde manifestement illusoire qu’on vient de décrire[11], transfigurant l’objet de désir en un univers de rêve. L’objet du désir décline le rapport entre soi et l’autre.
L’imitation est métaphorique, et le récit métonymique. Le futur philosophe part à la recherche romanesque de la vérité dans une quête de mémoire à long terme, retour à un passé lointain. Parménide se définissait lui-même, avant tout autre récit, comme chevalier errant « porté par les juments sur des chemins où l’on échange beaucoup de discours » : hippoi tai me ferousin…es odon polyphèmon (fr.1, v.1,2) , pour aboutir à un étant immobilisé.. L’imitation mimétique se réfère à l’être en tant qu’autre, au changement d’état qu’un être subit par l’action d’un autre être : le médiateur, et pour le médiateur à sa capacité d’opérer un changement dans un autre être : l’imitateur.
Puisque le monde parménidien n’est pas du temps des mortels « où la génèse et la destruction ont été bannies au loin, chassées par la certitude de la vérité », « epei genesis kai olethros têlé mal’eplakhthêsan, apôse dé pistis alêthês » (v.28), mais : « anarkhon apauston » (fr.8, v.27), « sans commencement et sans fin » du temps éternel de l’étant qui est au présent, il est logique de le concevoir comme l’imitation d’un modèle déjà là.
Il y aurait donc deux régimes différents de la garantie de la vérité, deux perspectives : le modèle médiateur générateur de récit, et le « mathème », élément d’une mathématique à venir dont on n’a retenu ici que le nœud borroméen et le raisonnement par l’absurde ; cela faute d’en avoir compris davantage, n’entendant vraiment pas le lacanien, si ce n’est qu’il veut lui aussi imiter un modèle médiateur : les maths modernes.
Revenons donc à la première perspective : le monde immobile, ou immobilisé, de Parménide, sur injonction de sa déesse, issu de son effort pour repousser par la raison le monde trompeur des sens et de l’opinion, la doxa, ce monde est engendré à travers son imagination, par l’imagination homérique de l’immobilité d’Ulysse, appliquant les recommandations de Circé la magicienne (Odyssée, XII) qu’il fait connaître à ses compagnons, avant de boucher leurs oreilles avec de la cire pour qu’ils n’écoutent pas les sirènes : « Fuyez les accents des sirènes au chant divin » : « sereinon thespesiaon phthogon alevastai » (v.158) tandis qu’elle m’ordonne de les entendre ; « mais liez-moi dans un lien pénible, tandis que je reste là fixé sur le sol »: « alla me desmô desat’en argaleô, ophr’empedon autothi mimno » (v.161), « droit sur l’emplanture, et là-même attaché à elle » : « orthon en istopedê, ek d’autou peirat’anêphto » (v.162) ; « mais si je vous commande de desserrer les nœuds, vous, serrez un tour de plus ! »
Le retour d’Ulysse à Ithaque, contrarié par les violences de Poséidon, inspire à Parménide un retour à un passé lointain, une recherche de la vérité avec l’aide de la déesse de la Raison, de la Sagesse et de la Prudence, qu’il ne nomme pas mais dont les traits ressemblent singulièrement à ceux d’ Athena aux yeux pers. Initiation peut-être, mais à une quête du désir de l’objet du désir d’un autre : le monde parménidien, immobilisé plutôt qu’immobile, où la doxa est repoussée dans le non-être ; initiation à l’image d’Ulysse ligoté à son mât, pour écouter sans lui obéir le chant des sirènes ; l’étant ligoté par d’autres liens[12], « par la justice qui ne relâchera pas les liens où elle le tient », « diké khalasasa pédesin all’ekhei » (fr.8, v.14-15) ; « par le destin qui l’a attaché » : « moira epedesen » (v.37), ; « c’est pourquoi il faut que l’étant( enfin nommè) ne soit pas illimité » : « ouk ateleuton to eon themis einai » (v.32), la double négation renforce la règle que l’étant, le monde est fini, limité en étendue (mais non dans le temps où il n’a ni début ni fin).
Le fragment 8 du poème reprend la recommandation de Circé, parfois avec les mêmes mots : comme Ulysse ligoté à son mât, l’étant, objet d’un désir copié sur celui d’Homère, est ici même « solidement planté au sol »: « khoutos empedon authi menei » (v.30) ; « la nécessité, qui le tient dans les liens de ses bornes « : « anagkê peiratos en desmoisin ekhei » ((v.31) remplace les compagnons, qui ligotent Ulysse.
Dans les deux cas il n’y a pas une immobilité véritable mais une immobilisation par des liens multiples, des forces extérieures : les compagnons d’Ulysse qui le lient en obéissant à ses ordres, sont imités par la nécessité, le destin qui coule comme le fleuve enfermé entre des berges qu’il a lui même construites en creusant son lit, comme Ulysse qui a ordonné lui-même qu’on le ligote à son mât pour résister aux sirènes.
[1] BACCOU R. : op. cit. p. 170.
[2] KUNDERA M. : L’insoutenable légéreté de l’être, Gallimard, 1984, pp 11-12 et 247.
[3] CASSIN B. : Quand lire c’est faire, in : Parménide, Sur la nature ou sur l’étant, Seuil, Points, 1998 p.63.
[4] SERRES M. : La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce, Editions de minuit,1977, p. 176. ; et La traduction, Editions de minuit, 1974, p. 113.
[5] BADIOU A. : 6ème et 7ème cours, in :Le Poème de Parménide, Entretemps, 1985
[6] Cité par : CASSIN B. : op. cit ; p. 292
[7] SHAKESPEARE W. : op. cit : Acte V, sc.IV, v.81
[8] CASSIN B. : op. cit. pp. 34, 212.
[9] BADIOU A. : Le Séminaire-Parménide, Fayard, 2014, pp.196-200
[10] GIRARD R. : Le désir « triangulaire », in : Mensonge romantique et vérité romanesque, Pluriel, Grasset, 1961, pp. 15.
[11] GIRARD R. : ibid. p. 31.
[12] CASSIN B. : op.cit , p. 55,57