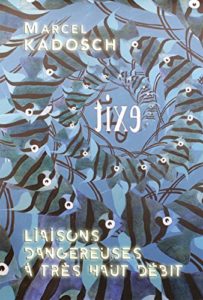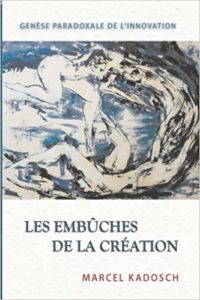Au lendemain de la guerre l’objectif d’une société de moteurs d’avion était d’étudier et de produire des moteurs à réaction, propulsant l’avion en lui appliquant une poussée égale et opposée à la quantité de mouvement d’un gaz éjecté vers l’arrière à grande vitesse.
Avant d’exposer ces recherches, rappelons les rêves à leur propos du philosophe Gaston Bachelard dont des amis me conviaient à cette époque à écouter les conférences à l’École Normale Supérieure, en même temps qu’un apologue imaginé par le poète Francis Jammes, dont j’ai pris connaissance un peu plus tard.
John le Sauvage du Meilleur des Mondes d’Huxley disait qu’un philosophe est un homme qui rêve « de moins de choses qu’il n’en existe sur la terre et dans le ciel ». Pour l’écrivain Raymond Quéneau, les philosophes étaient les visiteurs de Luna Park qui s’asseyaient devant un courant d’air artificiel pour le voir soulever les jupes des femmes, mais pas au point de les faire s’envoler[1]. Quant à Bachelard, sans pour autant négliger la connaissance scientifique des choses qui existent sur la terre et dans le ciel, il a longuement médité sur « la matière dont les rêves sont faits », et sur leur forme : en particulier celle du rêve de vol.
Contrairement à bien des penseurs de l’Antiquité, ainsi qu’à certains de leurs continuateurs modernes, Bachelard n’etait assurément pas un philosophe qui gardait les mains dans ses poches : il fut dans sa jeunesse employé des postes et racontait qu’il avait fait la découverte sensible de l’existence de la force d’inertie en coltinant des sacs postaux. Le poète Francis Jammes, dont il cite les expériences imaginaires aéronautiques, était dans la débine en 1937, et avait été discrètement aidé par Paul Louis Weiller, as de l’aviation pendant la grande guerre, puis directeur de la Société Gnome et Rhone : mécène des arts, il avait passé commande d’un livre au poète. Francis Jammes raconta donc en 1937, l’ histoire d’une visite rendue au « roi de l’air » (P.L. Weiller) et à son « infante » (sa fille Marie-Elisabeth âgée de treize ans), par « un philosophe très doux qui tenait ses mains enfoncées jusqu’au pouce dans les poches de veston[2] » : il s’appelait Henri Bergson, et l’interrogeait sur le mécanisme de l’avion ; en contemplant les efforts maladroits d’un poulet pour s’élever dans l’air, le philosophe se demandait si avec une suffisante volonté de puissance l’homme ne pourrait s’envoler sans ailes, comme le pitre du cirque Medrano qui accomplissait un double saut périlleux, comme Marie-Elisabeth elle-même, qui pratiquait l’op traken et à l’occasion le saut à skis, ces ailes au pied.
Bergson allait donc au cirque Medrano, et pourquoi pas à Luna Park, où l’on pouvait voir aussi le scenic railway et méditer sur l’équilibre métastable.
C’était ce rêve de vol que Bachelard traitait dans ses conférences[3]. Le bergsonisme, disait-il, revendiquait « l’étude du changement comme une tâche urgente de la métaphysique » : un être qui se déplace pour changer, dont le mouvement décèle une volonté de changement, ne s’étudie pas en intégrant la volonté de bouger dans l’expérience du mouvement. La cinématique ne donne que des tracés de trajectoires aperçues dans leur achévement, jamais vécu dans son déroulement circonstancié. Si l’on veut étudier les êtres qui produisent le mouvement, qui en sont les causes initiales, il faut remplacer la cinématique par la dynamique, les expériences positives de la volonté et de l’imagination.
C’est la poussée du psychisme qui a la continuité de la durée. L’imagination pratique la liaison des contraires : le passé passe au présent dans un dessein, éliminant les souvenirs vieillis ; le présent est à la fois la somme d’une poussée et d’une aspiration, associées dans une explication dynamique de la durée. Le vol onirique constitue l’être comme mu et mouvant, mobile et moteur. Le pilote, l’aviateur réalisent la synthèse du mu et du mouvant, intuition bergsonienne du mouvement. Bergson décrit comme suit ce que nous devrions ressentir :
« Nous nous installons dans l’immobile pour guetter le mouvant au passage, au lieu de nous replacer dans le mouvant pour traverser avec lui les positions immobiles. Nous prétendons reconstituer la réalité qui est tendance et par conséquent mobilité avec les percepts et concepts qui ont pour fonction de l’immobiliser. Avec des arrêts on ne fera jamais de la mobilité ; au lieu que si l’on se donne de la mobilité on peut en tirer par la pensée autant d’arrêts que l’on voudra…il n’y a aucun moyen de reconstituer, avec la fixité des concepts, la mobilité du réel[4] »
Il faudrait se donner aussi par la pensée autant d’instants dans la durée que d’arrêts dans l’étendue. Bergson oppose ainsi la vision de Lagrange à celle d’Euler sur la mécanique des fluides. Imaginons par la pensée Euler (ou Parménide), et Lagrange (ou Héraclite) munis d’une caméra et d’une horloge. Le premier immobile comme un « poteau indicateur » sur la rive du fleuve filme une suite de bateaux qu’il voit passer : « il reste dans son rôle en ne faisant pas la route lui-même[5] »
Le second immobile comme Ulysse attaché pour résister au chant des sirènes au mât de son bateau, qui se baigne tout le temps dans le même fleuve, filme une file de peupliers sur la rive qui restent dans leur rôle en ne faisant pas la route eux mêmes : deux visions équivalentes de la mobilité, la même connaissance relative au signe près.
Le caillou qu’on lance, qui ne change pas et décrit une parabole n’est qu’un être géométrique ; pour expliquer le mouvement il fallait examiner des êtres dont « un changement intime soit la cause de leur mouvement » ; en somme passer du lancement d’un ballon au coup de pied dans un chien, par Bateson ou par Malebranche, mais comment créer un chien vivant ?
« le passé n’est pas un arc qui se détend, l’avenir une simple flèche qui vole, parce que le présent a une éminente réalité. Le présent est la somme d’une poussée et d’une aspiration[6] »…
Le problème essentiel pour donner l’image dynamique de l’élan vital « c’est de constituer l’être comme mu et mouvant, comme mobile et moteur, comme poussée et aspiration ». Cela rejoint dans un sens la vision homéodynamique ( plutôt qu’homéostatique) de l’organisme vivant inaugurée par Claude Bernard, mais s’applique-t-elle à un objet artificiel?
Rappelons le fonctionnement du turboréacteur qui propulse un avion à réaction à la vitesse ve mètres par seconde dans le système international : il aspire à son entrée en tête de l’avion l’air atmosphérique à la vitesse relative : –ve et après l’avoir comprimé et brûlé du kérosène autour dans ses « poumons » éjecte vers l’arrière du gaz à une vitesse très supérieure produite par une turbine : –vs mètres par seconde.
Le turboréacteur exerce sur l’avion une force qui le propulse, par une poussée égale (en newtons) au produit du débit-masse d’air : m kilogrammes par seconde, par la différence des vitesses :
(vs – ve), qui constitue bien alors « le présent , somme d’une poussée et d’une aspiration ».
Le coup de pied au chien fait émerger aussi dans le présent l’énergie canine produisant la somme d’une aspiration et d’une poussée dans la machine vivante chien.
Autre présent mais conditionnel : l’appareil respiratoire, moteur aérien qui aspire de l’air, brûle son oxygène mais expire le gaz carbonique sans poussée sauf nécessité ; il est au présent le moteur de la machine chien, mais il rappelle aussi au présent sans mouvement le turboréacteur qui activé par le pilote est chauffé sur place quelques minutes avant de pousser l’avion au décollage, ou celui qui a fonctionné sans bouger auparavant pendant de longues heures sur un banc d’essais afin qu’on s’assure de son bon fonctionnement.
Quand la SNECMA a réussi à en construire à son tour, elle a provoqué la curiosité de nombreuses personnes qui ont demandé à voir la nouvelle merveille. Un ingénieur fut désigné d’office pour organiser des visites au banc d’essai de Villaroche, et accomplit cette corvée d’assez mauvaise grâce dans le langage vernaculaire de l’atelier («les mots de la tribu»), différent de celui du poète et du philosophe. Il tenait le discours expéditif suivant :
―Par ce bout de l’appareil il entre de l’air, et une pompe injecte par ce trou du kérosène, qu’on brûle dans ces cages. À l’autre bout il sort un gaz très chaud et très rapide. Entre les deux bouts, ça se démerde.
Si l’un des curieux s’avisait de demander :
―C’est quoi qui se démerde ?
― C’est un moulin qui va très vite, et qui est très difficile à construire…
Il valorisait ainsi au passage sa propre contribution, et tentait peut-être d’exprimer à sa manière l’idée que le turboréacteur était issu d’une volonté humaine de suivre pour s’y adapter une tendance inconsciente de la machine à l’auto-organisation d’un « changement intime cause de son mouvement » : une grille d’aubes de compresseur et une grille d’ailettes de turbine sont parcourues par un écoulement de gaz qui improvise au passage son adaptation aux parois solides par lesquelles le créateur détermine le mouvement qu’il veut imprimer.
Mais avant d’aborder les rêves de l’ingénieur, précisons davantage les vrais rêves des philosophes Bergson et Bachelard, dont nous n’avons considéré jusqu’ici que la partie la plus facile : fallait-il vraiment commencer par rêver d’un mouvement horizontal ?
Selon Bachelard commentant Bergson, « c’est dans le voyage en haut que l’élan vital est l’élan hominisant… qui ne monte pas tombe… L’homme en tant qu’homme ne peut vivre horizontalement[7] ».
L’homme rêve de vol vers le haut. Dans un premier temps cela nous fait revenir au problème du bas et du haut, préoccupation humaine essentielle qui reviendra comme un leit motiv dans toutes les recherches sur le mouvement évoquées par la suite. Pourquoi l’ascension ne serait-elle que rêvée ? En vertu du principe d’Archimède un corps plus léger que l’air comme un ballon gonflé d’hélium monte, poussé vers le haut par l’air ambiant qui vient prendre la place qu’il a laissée, en montant un petit peu lui aussi, poussé par lui-même : un calcul intégral montre que la poussée d’Archimède opposée au poids accélère dynamiquement vers le haut la masse du ballon alourdie d’une «masse supplémentaire hypothétique» équivalente à la moitié de la masse d’air ambiant déplacée ; l’accélération vers le haut vaudrait donc environ les deux tiers de la pesanteur.
Mais ce n’est pas à ce genre d’ascension que rêvent nos philosophes. Les oiseaux et les insectes ont bien appris à voler dans leur milieu, pour manger et pour ne pas être mangés. Les hommes ont réussi à les imiter en faisant voler un avion: avant cela en tirant un planeur, et bien longtemps auparavant en plaçant dans le vent un cerf volant. Dans tous les cas, et que le corps soit poussé ou tiré, par un « changement intime » d’un moteur ou par la traction d’un câble extérieur, c’est cette poussée-aspiration créant un mouvement horizontal relatif par rapport l’air ambiant qui a entraîné vers le haut une partie de l’objet volant : manifestement celle qui a la forme d’une aile d’avion fendant l’air, ou d’un cerf volant dans un vent relatif.
En avançant horizontalement, l’aile pousse l’air situé sous son ventre vers le bas jusqu’au sol, et tire vers le bas, jusqu’au ciel, l’air situé sur son dos ; réciproquement l’air ainsi tiré par l’aile vers le bas tire en réponse l’aile vers le haut, par une force verticale qui a reçu le nom de portance, et qui n’a rien de métaphysique. L’aile et l’air ambiant forment le milieu associé à l’individu moteur pour que l’ensemble avion vole. Pour qu’il décolle du sol et qu’il y atterrisse, le milieu doit joindre à l’air ambiant sa borne inférieure solide ou liquide, qui figure « le bas ». Dans cette description physique, l’air est une matière, caractérisée par une masse pesante (attirée par la Terre) et inerte (soumise à la rotation de la Terre).
Le « cerf » volant est en fait une déformation de « serpent » volant. Des chinois marins experts en voiles l’ont découvert il y a fort longtemps et en ont fait un objet artificiel, leur servant de signal, ou d’épouvantail ; mais la forme de dragon volant sous laquelle ils le faisaient voler donne à penser qu’il avait rempli d’abord à leurs yeux une fonction magique.
Si nous nous souvenons des tortues ou éléphants géants sur lesquels ils croyaient que la terre reposait, il n’est pas impossible qu’ils aient cru que le cerf volant posait son ventre sur des dragons rampants s’appuyant sur le sol pour le repousser vers le haut, en même temps que son dos était aspiré vers le haut par une tour de dragons volants montant jusqu’au ciel. Dans les croyances populaires, l’air invisible n’était pas perçu comme une matière pesante mais comme un mouvement : le cerf volant ne flotte pas dans l’air comme la feuille sur l’eau, il est porté par l’objet vent. Les dragons volants bien visibles descendant du ciel pour devenir des dragons rampants supportant le cerf volant sont la pluie, la grêle, la neige, l’arc en ciel, etc…
Or à l’inverse des tortues ou éléphants soutenant la Terre que les chinois ont vite abandonnés quand des jésuites leur ont révélé la vision occidentale du haut et du bas, cette explication par des dragons du vol des oiseaux et plus tard des avions est bien plus proche de la réalité que celle, très fantaisiste, avancée de nos jours par certains scientifiques qui s’imaginent que l’air « colle » au dos de l’aile par une « vertu collante » semblable à la vertu dormitive de l’opium[8].
Un bon moyen de prouver l’existence des girafes est d’en montrer quelques unes, a rappelé Herbert Simon : on ne peut expliquer la portance d’une aile, qui la tire vers le haut, en ignorant l’existence des tourbillons, « dragons » plus gros que l’avion parce que composés d’air mille fois plus léger, et dont on peut trouver une grande variété de photos sur Internet[9], la figure ci-après n’en étant qu’un exemple.
Provenant de l’environnement externe à l’aile et non de son changement intime, il est à craindre que ces dragons produisant un élan vital vers le haut ne satisferont pas les philosophes malgré l’évidence, et qu’ils continueront à rêver éveillés. Mais le turboréacteur vient heureusement à leur aide en concrétisant une intériorisation du phénomène : le compresseur et la turbine sont des machines tournantes à l’intérieur d’une enveloppe de révolution et autour d’un axe horizontal ; sans entrer dans le détail, l’écoulement d’air aspiré à travers les aubes du compresseur, de gaz poussant à travers les ailettes de la turbine, engendre un changement effectivement intime, cause du mouvement horizontal de ce moteur qui engendre à son tour une portance des ailes de l’avion mu par ce moteur, verticale de bas en haut si le moteur est horizontal : les gaz circulant entre les aubes, entre les ailettes, aspirent leur dos et poussent leur ventre, engendrant ainsi une portance perpendiculaire à l’axe du moteur qui produit une rotation autour de cet axe, laquelle entraîne à son tour l’aspiration et la poussée des gaz productrices de l’avancement de l’appareil.

Fig. Tourbillons liés à l’aile de l’avion
Au total l’objet volant est soumis d’une part à la pesanteur, d’autre part à une poussée suivant l’axe du moteur, à une portance perpendiculaire à cet axe, équilibrant le déplacement de l’air de l’atmosphère en sens inverse autour de l’aile, et des forces dissipatives de résistance au mouvement de l’objet. Il peut ensuite évoluer dans tous les sens dans les airs, où il n’est plus astreint à un mouvement horizontal dès qu’il a décollé.
[1] QUÉNEAU R. : Pierrot mon ami, Gallimard, 1942.
[2] JAMMES F. : La légende de l’aile ou Marie-Elizabeth, La Cigale, Uzès,1938
[3] BACHELARD G. : L’air et les songes, José Corti, Paris 1943, pp.289-293
[4] BERGSON H. : La Pensée et le mouvant, pp 212-213.
[5] MICHAUX H. : L’époque des illuminés, in Qui je fus, Gallimard, 1927.
[6] BACHELARD G. : op. cit. pp.289-293
[7] BACHELARD G. : op.cit., p.19
[8] KADOSCH M : Avatars de la vérité, CreateSpace 2015, ch. 7, pp.97-105
[9] La Portance-Inter Action, in : inter.action.free.fr/