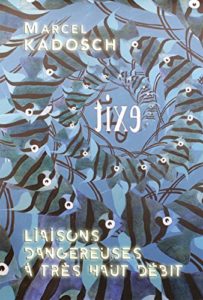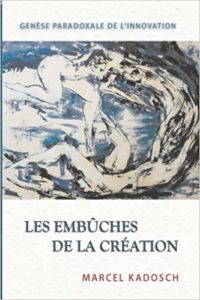À la rentrée d’octobre 1944 on m’a nommé maître auxiliaire de mathématiques au Lycée Lyautey de Casablanca , où j’ai retrouvé quelques uns de mes anciens professeurs, et j’y ai continué à préparer le concours d’agrégation.
Ordre de mission
Peu après il s’est produit un incident imprévu: j’ai reçu en janvier 1945 un ordre de mission du Ministère de l’Industrie (papier officiel de la 4ème République traversé par un ruban tricolore)me déclarant de nationalité française et m’enjoignant de rejoindre au plus vite l’Ecole des Mines de Paris, demandant à toutes autorités de faciliter mon voyage. Il ne contenait aucune précision sur le motif et l’objet de la mission.
Il m’était facile de répondre que c’était une erreur: je n’étais pas de nationalité française, je n’avais pas à recevoir d’ordre de mission. J’ai hésité un moment: notre mésaventure avec le passeport espagnol de mon père m’avait laissé un mauvais souvenir. Puis je me suis dit que c’était l’occasion que j’attendais depuis longtemps de quitter enfin le Maroc.
Je suis parti en Mars 1945 pour Alger où l’on m’a inscrit une fois de plus sur une file d’attente: la fonctionnaire qui m’a reçu m’a montré sur sa table la pile d’ordres de mission émis par Paris sans considération des moyens de transport disponibles.
J’ai retrouvé à Alger mon ami Moatti qui avait combattu dans le maquis, préposé à la conduite d’une traction avant qui transportait des dinamiteros ravitaillés en explosifs, ayant pour mission d’opérer des destructions. Il avait obtenu une permission pour voir sa famille.
J’ai revu à Alger mes ex-bizuths,. Ils ont réussi au concours de Polytechnique, ou à celui de Normale Supérieure, et n’étaient pas encore démobilisés bien que la campagne de France fût terminée. Nous nous sommes revus plus tard à Paris.
J’ai pu embarquer pour Marseille fin Avril 1945 seulement, en longeant les côtes d’Espagne. En arrivant en rade de Marseille le premier mai, nous avons eu la surprise de voir l’église Notre Dame de la Garde couverte de neige !
Arrivé à Paris, je me suis rendu à la Maison des Mines, où mon camarade Jean Fabri m’a reçu: pour rester en vie, il avait dû se réfugier pendant les années noires dans une ferme et participer aux travaux des champs ; il m’a informé que nous étions inscrits en deuxième année. La Maison des Mines m’a aussitôt hébergé dans une chambre et nourri pendant mon séjour.
Après cette visite, je me suis rendu tout d’abord au Ministère de l’Education Nationale, pour l’informer que j’avais présenté ma candidature au concours d’agrégation à Casablanca, mais que je n’y étais plus puisque j’étais venu à Paris.
Le fonctionnaire qui m’a reçu, M. Pozzo Di Borgo, a cherché partout :
—Nous avons bien reçu des dossiers de candidature de Casablanca, m’a-t-il dit, mais aucun de ces dossiers n’est à votre nom. Enfin l’essentiel est que vous soyez là: le concours commence la semaine prochaine.
Je lui répondis qu’il recevrait sûrement mon dossier après le concours ! Il me donna des carnets de tickets de rationnement pour des morceaux de pain de 750 grammes, destinés aux travailleurs de force : les épreuves du concours d’agrégation durent sept heures chacune !
Reçu ensuite à l’École des Mines par le sous directeur, M. Fischesser, je le remerciai de m’avoir réintégré à l’École. Il me répondit:
—la France n’a jamais cessé d’être une république, et le Gouvernement a décrété que toutes les décisions du gouvernement parfaitement illégitime de Vichy sont nulles et non avenues. Vous n’êtes donc pas réintégré, vous avez toujours été élève ingénieur; mais vos études ont été perturbées par les événements, vous n’êtes pas le seul !
Tiens ! c’est curieux, j’ai déjà entendu cette histoire: un ancien n’a jamais été bizuth ! Pétain en avril 1945 a été applaudi à Paris par une foule aussi grande que celle qui a défilé fin Août à la Libération derrière De Gaulle. Beaucoup étaient peut-être les mêmes: encore un coup de la logique temporelle ?…
Je m’enquis de la nature de ma mission. Fischesser me déclara à ce propos :
—L’hiver 44-45 a été très rude. La France a grelotté. Elle a un besoin urgent de charbon, du travail de ses mineurs dans les mines de charbon, elle a donc besoin d’ingénieurs des mines ! Et maintenant, allez vite rejoindre vos camarades sur les bancs de l’amphi: nous avons un professeur extraordinaire qui a inventé une science nouvelle: l’économétrie, une manière scientifique de traiter l’économie…
Il s’agissait de Maurice Allais, futur Prix Nobel. Mais pour moi l’économie n’était qu’une forme déguisée de comptabilité; je ne voulais faire que de la science, ce n’en était pas une à mon avis, et je m’ennuyai ferme au cours dont je ne tardai pas à adopter la qualification de « déconométrie. »
Maurice Allais mettait en équation les prix du beurre et de la margarine, et en déduisait comment varierait le prix du beurre si celui de la margarine augmentait; ou peut-être était-ce le contraire. Voulant étudier la notion de taux d’intérêt, il l’avait désigné par la lettre grecque: ρ (ro). Il répétait sans cesse: —Soit le taux ro,
ce qui nous faisait rire comme des idiots.
En revanche je me montrai intéressé par un calcul entrepris par un de mes camarades, Dubroeucq, précurseur de la Recherche Opérationnelle, en vue de déterminer s’il fallait changer à la station Odéon ou à la station Saint Michel du métro pour aller de la rive droite à la rive gauche et rejoindre l’École. Le calcul montrait que le facteur déterminant était le temps de réponse de la poinçonneuse de Saint Michel, qui ne se séparait jamais de son ouvrage à tricoter, poinçonné par ses aiguilles entre deux trous dans les tickets. Serge Gainsbourg n’avait pas encore étudié le problème.
J’ai donc passé le concours à Paris, à partir du 8 mai 1945, date historique, dûment fêtée en compagnie de mes camarades Rapoport et Moatti, retrouvés à Paris.
Pozzo Di Borgo m’a convoqué trois mois plus tard fin juillet à l’Education Nationale, pour m’annoncer:
— Je viens de recevoir votre dossier du Maroc: vous aviez raison, il a été acheminé avec un gros retard pour vous empêcher de passer le concours !
J’ai été reçu à l’agrégation avec le numéro 3 bis. Était-ce avant ou après la bombe atomique de Hiroshima, objet de tous les commentaires à l’époque, je ne m’en souviens plus: elle ne m’a pas vraiment surpris, notre professeur de physique nous en avait expliqué la possibilité dès 1941. Mon professeur de machines à l’École a fait le commentaire suivant:
—Au lieu d’être écrabouillés par l’explosion, brûlés par le phosphore comme à Dresde, nous serons grillés: c’est quand même plus propre !
Cela m’a laissé un malaise, même sans savoir: on parlait de rayons gamma, mais sans la moindre idée des ravages qu’ils provoqueraient.
Le Maroc m’a attribué une petite bourse de recherche, et je me suis gardé de solliciter un poste de professeur agrégé. Je n’avais jamais eu l’intention de faire de l’enseignement. Je me suis donné du mal pour passer l’agrégation, parce que l’administration du Maroc se donnait du mal pour m’en empêcher.
En un combat douteux
L’ordre de mission qui m’avait permis de quitter le Maroc m’avait conduit à Paris, mais je n’étais là que pour passer ce concours et finir l’Ecole des Mines: un diplôme d’ingénieur ça peut toujours être utile, même mal payé !
Dès ce mois de mai 1945, je m’étais rendu au consulat des Etats Unis pour demander un visa d’immigration.
Le procès de Pétain s’est ouvert en Juillet. Il sera finalement condamné à mort « pour intelligence avec l’ennemi », et envoyé à l’Ile d’Yeu où il mourra dans son lit en 1951, honoré par près de la moitié des français.
Intelligence avec quel ennemi? La Wehrmacht, évidemment: les Allemands occupants. Pas Hitler, pas les nazis, allemands ou non. On a parlé à peine de son action antijuive, de la milice: le sujet ne passionne pas les parisiens que je rencontre, qui en 1945 n’en ont que pour la Résistance contre l’occupant.
Qu’en a-t-il été au Maroc pendant le temps que j’y ai vécu ?
Sous la troisième République jusqu’à la défaite de 1940, j’étais considéré comme un « dhimmi des français », situation préférable à celle de dhimmi des marocains, en dépit des quelques injustices dont j’aurais pu me plaindre : le français qui me protégeait d’éventuelles exactions me considérait tout de même comme un « indigène ».
Officiellement la France et la Grande Bretagne avaient déclaré la guerre en 1939 à l’Allemagne pour défendre la Pologne attaquée, et plus généralement le Traité de Versailles : je ne me sentais pas vraiment concerné sur ce terrain, je trouvais absurde que français et allemands s’arrachent une troisième fois l’Alsace et la Lorraine : même Proutier, mon professeur nationaliste trouvait cela stupide: à ses yeux, en 1913, les alsaciens étaient bel et bien redevenus allemands; mais pas les lorrains: se sentaient-ils français ou polonais? Par ailleurs les hitlériens et les polonais rivalisaient en antisémitisme, et Daladier enfermait dans des camps les réfugiés allemands, juifs compris, qui avaient fui les nazis, craignant que des espions en aient profité pour s’infiltrer parmi eux.
À la défaite, j’ai compati aux malheurs des français, dont j’ai partagé le sort pendant mon séjour en France ; la France avait été battue et avait demandé l’armistice : je n’avais aucun motif pour m’élever contre l’occupation de la France, pour participer à un combat contre les « Boches », comme disaient les gaullistes et plus tard les communistes, et on ne les voyait même pas en zone non occupée ni au Maroc. J’avais de très sérieux motifs de craindre Hitler et les hitlériens, allemands ou français, mais n’avais aucune raison de faire une différence entre un nazi allemand et un nazi français, dont je voyais que l’influence prépondérante s’imposait à Vichy, gouvernée à mes yeux par des gauleiters.
Pendant l’occupation, on n’a vu au Maroc aucun uniforme allemand dans les rues, comme on en montre dans le film: Casablanca. Mais l’Omnium Nord Africain chargeait son minerai stratégique de cobalt et de manganèse sur les cargos allemands ; elle le chargea plus tard sur les cargos américains, point.
« Conventions collectives »
En Octobre 1945, les cours de troisième année de l’Ecole des Mines de Paris qui m’intéressèrent le plus furent ceux de thermodynamique et des moteurs. Voyant cela Léon Rapoport me mit en relation avec son frère Eugène Rapoport, ingénieur de l’Aéronautique, qui travaillait dans un Groupe d’Etudes de Moteurs à Huile Lourde, pour l’aviation. Je fis ainsi la connaissance du directeur Raymond Marchal qui après m’avoir posé des questions de thermodynamique fut satisfait de mes réponses et me proposa de m’embaucher dès que j’aurais fini mes études. En attendant de faire un beau voyage comme Ulysse, j’acceptai cette proposition, à titre provisoire dans mon esprit. En tous cas j’étais bien décidé à ne jamais descendre dans une mine de charbon, comme le firent les trois quarts de mes camarades de promotion, attirés par des conditions avantageuses dans les nouveaux Charbonnages de France nationalisés.
A la suite de l’hiver très rigoureux de 1944-1945, la France avait essayé d’obtenir des Alliés une participation à l’occupation de la Ruhr et à la consommation de son charbon, mais elle lui fut refusée, ce qui contribua à renforcer une hostilité latente envers les américains, dont quelques uns se conduisaient comme des occupants de la France. L’orchestre à la mode de Jacques Hélian obtint beaucoup de succès avec la chanson suivante :
Ah, si nous avions un jour, le charbon de la Ruhr dans nos calorifères !
Oui, mais nous ne l’avons pas, Qu’alors qu’alors y faire ?
Le diplôme d’ingénieur civil des mines m’a été décerné fin Mars 1946: j’avais devancé de trois mois ma sortie normale en juin 1946 en remettant mes rapports de fin d’études, car j’avais un besoin urgent d’argent pour des dépenses de première nécessité. Quand je me suis présenté au Groupe d’Etudes des Moteurs à Huile Lourde (GEHL) à Suresnes, j’y ai appris que Raymond Marchal venait d’être nommé Directeur Technique de la Société Nationale d’Etudes et de Construction de Moteurs d’Avion (SNECMA), créée par le ministre communiste Charles Tillon pour regrouper autour des usines Gnome et Rhône la plupart des usines s’occupant de moteurs d’avion excepté Hispano Suiza qui gardait son indépendance. J’ai donc été embauché par la SNECMA et non par le GEHL, et j’ai fait connaissance à cette occasion avec la toute nouvelle Convention Collective de la Métallurgie Parisienne, et le Comité Mixte à la Production, filiale du Comité d’Entreprise.
N’étant plus élève ingénieur, j’ai dû chercher à me loger en ville chez l’habitant: je n’y ai malheureusement pas retrouvé l’atmosphère très accueillante de Saint Etienne; ce fut pour moi l’occasion de me rendre compte qu’au lendemain immédiat de la guerre le petit peuple de Paris et de sa proche banlieue intoxiquée par la propagande du Parti Communiste et qualifiée pour cette raison de « zone rouge », était resté marqué sous une forme xénophobe par l’antisémitisme prêché sous Vichy, aggravé par un antiaméricanisme naissant.
Les premières années de la SNECMA ont été difficiles: l’entreprise nationalisée avait une capacité de production de moteurs obsolètes, et faute de commandes fabriquait des tracteurs invendables. Divers industriels furent pressentis pour la diriger, redresser sa situation, notamment le constructeur d’avions Henri Potez.
Oasis
Les diplômes que j’avais acquis ne m’apportaient au départ aucune considération particulière, et j’étais jugé sur ma mine qui était loin d’être brillante.
La SNECMA m’a embauché en 1946 comme ingénieur de recherches , et à la suite de mon entretien d’embauche, j’imaginais que j’aurais à étudier la thermodynamique des moteurs. Mais Suresnes avait commandé un banc d’optique pour réaliser un faisceau de lumière polarisée[1], dans lequel on envisageait de placer des maquettes en plexiglas transparent de pièces de moteur, en vue de repérer leurs points faibles de résistance. On me demanda de m’occuper de ce travail, auquel on semblait attacher beaucoup d’importance : il permettait d’évaluer la différence entre les contraintes principales. Il était prévu qu’à la rentrée de septembre je serais secondé par un autre ingénieur de grande école !
En Mai 1946 on m’envoya à l’École de Physique et Chimie Industrielle de Paris pour m’initier à ce genre d’études. Ce fut mon premier travail dans l’industrie, et l’objet d’une cascade de surprises.
Alors que je travaillais sur le banc d’optique de cette École, je vis arriver un jour une jeune femme pimpante qui traversa le laboratoire d’un pas décidé sans me voir en direction du chef de travaux pour lui demander des nouvelles de son travail d’étudiante: une cuve rhéographique, servant à évaluer la somme des contraintes principales, en complément du banc d’optique: étude qui ne m’avait pas été enseignée à l’Ecole des Mines, et dont j’ignorais par conséquent l’existence et la justification scientifique..
—Bonjour Mademoiselle, répondit le chef. Vous tombez bien ! Permettez que je vous présente M. Kadosch, qui est agrégé de maths et ingénieur des mines, et avec qui vous allez travailler à partir de septembre.
La jeune personne prise de court tourna la tête de mon coté, sous un angle voisin de celui de la polarisation, et à ma vue émit un grognement de surprise atterrée:
—Heu c’est pas vrai !?
Que pouvais-je en penser, moi qui débarquais depuis peu de mon Maroc natal, vêtu de guenilles, portant des lunettes noires, le stock des blanches étant épuisé là-bas? Je me suis dit sur le moment : Bon, cette jeune personne me trouve une tête de métèque (une mine… pas tibulaire mais presque! dira plus tard Coluche). Pourrons-nous travailler ensemble ?
Elle disparut de la salle pour aller voir sa cuve rhéographique et «calculer la somme». Je demeurai devant mon banc d’optique assommé par l’évènement: j’ai vaguement réalisé sa ressemblance imprévue avec l’échouement d’Ulysse en haillons poursuivi par la colère de Poseidon, sur le rivage de la Phéacie, faisant face à la princesse Nausicaa, qui se tenait debout devant lui, sans doute en position d’attente de karaté.
N’aurais-je pas dû alors me précipiter à ses genoux symboliquement, et lui déclarer, inspiré par Homère:
«Vous me voyez ravi, chère future collègue, mes yeux n’ont jamais vu votre pareille, votre aspect me confond: je vous admire, mais je tremble, d’où je viens, vêtu de haillons.., prenez pitié, vous êtes la première que je rencontre… » Cette présence d’esprit me manqua, mais ce n’était que partie remise: je la reverrais le premier septembre, d’ici là revêtu d’un costume décent; je lui ferais la cour, et lui demanderais à la première occasion favorable si elle voulait bien m’épouser…
Au mois de juin 1946 après mon stage, je me rendis chez le directeur de l’usine de Cachan chargée de fabriquer le banc d’optique commandé, et je lui demandai dans combien de semaines, ou de mois, l’appareil serait livré. Il me regarda avec stupeur comme si j’avais proféré une énormité :
—Mais Monsieur, il est prévu que ce banc vous sera livré en 1949 !
Je pense à ma propre stupéfaction d’alors : dans trois ans ! Aujourd’hui je me dis : seulement trois ans ?
Je revois rétrospectivement le petit père Tardy déambulant dans son usine d’optique, entre des cristaux biréfringents et des oculaires, soucieux d’obtenir la plus grande précision. J’ignore quelle était sa religion, mais je n’ai aucun doute sur ce qu’il aurait fait si on lui avait proposé pour la construction de ses appareils des cornées d’une transparence parfaite, d’une « complexité irréductible » créées dans un « dessein intelligent » par un Grand Horloger, il y a cinq mille sept cent soixante douze ans et inchangées depuis, ce qui prouvait leur perfection : après les premières mesures de réception optique elles auraient atterri dans la poubelle.
Dans trois ans tout de même ! De retour à Suresnes, j’informai de cette situation le Directeur du Centre et lui demandai de quoi j’allais m’occuper en attendant. Il fut entendu que je seconderais Eugène Rapoport, frère de mon ami Léon, et un jeune ingénieur en chef nommé Jean Bertin dans leurs études thermodynamiques.
Au mois de septembre 1946, la jeune fille se présenta en effet à l’usine de Suresnes, mais elle s’était mariée entre temps et son mari était aussi embauché.
Nous avons fait plus ample connaissance et sommes devenus les meilleurs amis du monde : c’est en grande partie à cause d’eux et de leur cercle d’amis et connaissances que j’ai fini par oublier les États Unis pour rester en France.
Fort heureusement, ce service de recherches, et les services d’études des autres centres, y compris celui des essis de machines au sol et en vol sur le terrain de Melun Villaroche, étaient composé d’ingénieurs, de techniciens, de dessinateurs d’études, et même d’ouvriers professionnels de troisième catégorie (qu’on appelle en France bêtement «P3», mais en Italie: «mecanico supremo» ! ) qui pour la plupart ne partageaient pas les idées en vigueur dans le prolétariat local, mais plutôt celles de la majorité de la population : je m’y suis fait un assez grand nombre d’amis qui m’ont encouragé à rester là.
[1] Banc de photoélasticité